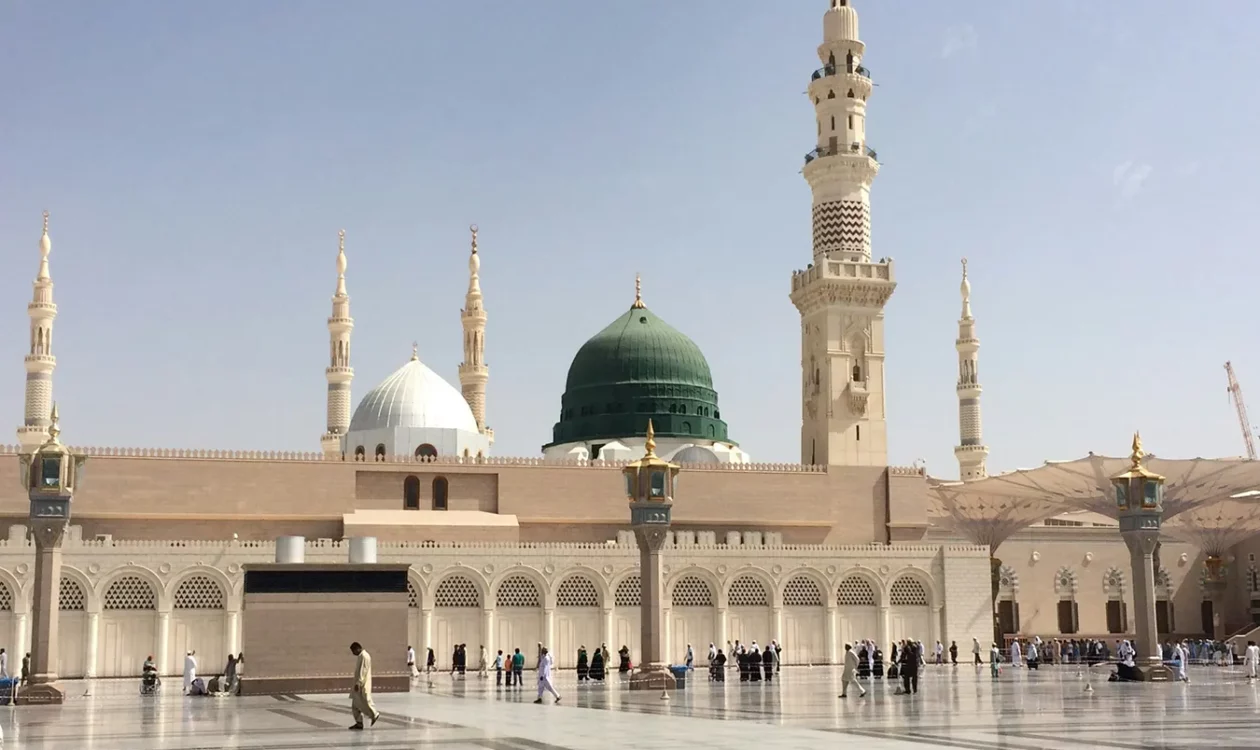Au milieu de l’incertitude mondiale qui suit l’imposition des tarifs douaniers du président Trump, une chose est sûre : les Etats du Golfe cherchent activement de nouvelles alliances multipolaires et y investissent. Rien qu’en avril 2025, les EAU et l’UE ont convenu de lancer des négociations de libre échange, tandis que l’Arabie Saoudite a renforcé son accord de coopération énergétique avec l’Inde et la société chinoise Sinopec. Ces accords font suite à une série d’accords commerciaux et d’investissement conclus ces dernières années entre les Etats du Golfe et divers partenaires internationaux. L’Arabie Saoudite et le Brésil ont ainsi convenu de renforcer leurs liens dans les secteurs de la défense et de la banque ; Oman et le Koweït renforcent leur coopération avec la Chine dans le domaine de l’énergie solaire ; et les EAU comptent désormais 26 partenaires dans le cadre de leur « Partenariat Economique Global ».
Ces évolutions interviennent alors que le commerce mondial est confronté à la volatilité géopolitique, à l’augmentation des droits de douane et aux politiques économiques protectionnistes. Les récents droits de douane imposés par Trump ont également exercé une pression importante sur le commerce international. Bien que les exportations de pétrole soient exemptées de ces droits de douane, le CCEAG est confronté à des risques d’inflation et à l’incertitude commerciale. La région dépend en effet des Etats-Unis pour ses importations en matière de sécurité et de défense et les devises du CCEAG sont liées au dollar américain, ce qui les rend vulnérables à toute fluctuation. En outre, le Golfe reste menacé par les attaques menées par les Houthis contre les navires commerciaux en Mer Rouge et par la perspective d’hostilités ouvertes entre Israël, l’Iran et ses « proxies » au Moyen-Orient. Cela pose un risque direct pour les routes d’exportation et le flux de marchandises passant par la région.
Les droits de douane américains de 10 % auront probablement un impact minimal sur les économies du Golfe productrices de pétrole, comme l’Arabie Saoudite en raison de sa stratégie d’importation diversifiée, de ses liens commerciaux étroits avec la Chine et de l’exemption du pétrole de la liste. Les faibles coûts de production du pétrole du royaume renforcent sa compétitivité, d’autant plus que les producteurs de gaz de schiste américains sont confrontés à une hausse des coûts de production à la suite des droits de douane qui ont gonflé le prix de l’acier. Néanmoins, la décélération actuelle du commerce mondial exercera une pression à la baisse sur les Etats du Golfe, compte tenu de leur position géostratégique en tant que plaques tournantes du commerce. La réduction attendue du transport maritime et du fret aérien est un défi majeur, en particulier dans le contexte de prix du pétrole bas. Toutefois, de nouvelles opportunités se présenteront, notamment avec l’émergence de nouveaux corridors commerciaux entre l’UE, l’Inde, la Chine et l’Afrique. Les Etats du Golfe peuvent tirer parti de ces itinéraires en investissant dans leurs infrastructures maritimes et logistiques.
L’impact de la récente politique américaine se fait déjà sentir dans la région, avec une baisse de 0,61 % de l’indice saoudien Tadawul et des baisses d’autres marchés boursiers du Golfe. Les politiques tarifaires perturbent également les chaînes d’approvisionnement et augmentent considérablement le coût des matières premières. En outre, les droits de douane importants imposés aux exportations chinoises et asiatiques ont perturbé les chaînes d’approvisionnement et réduit globalement la confiance mondiale dans le commerce avec les Etats-Unis. Face à ces défis , les Etats du Golfe diversifient activement leurs partenariats stratégiques et économiques avec d’autres puissances émergentes et établies dans le monde.
Si le retour de Trump à la Présidence a poussé les pays du Golfe vers des alliances multipolaires, il n’en est pas le seul déclencheur. Ces dernières années, les gouvernements comme les entreprises se sont préparés à atténuer les chocs géopolitiques et les risques stratégiques. Les derniers tarifs douaniers constituent l’un de ces chocs parmi une série de scénarios que ces entités ont tenté d’anticiper et de traiter. Depuis le début du 21e siècle, divers évènements, notamment la demande croissante d’énergie de la part de l’Inde et de la Chine, l’autosuffisance croissante de la production pétrolière aux Etats-Unis et au Canada, le Brexit et les guerres régionales, ont poussé les Etats du Golfe à envisager de diversifier leurs relations commerciales et diplomatiques. L’évolution du Golfe vers des alliances multipolaires a donc été une tentative de sauvegarder son autonomie stratégique dans le cadre de l’évolution de la donne internationale au cours de la dernière décennie. Alors que la dépendance à l’égard des alliés occidentaux traditionnels devient moins certaine, les Etats du Golfe approfondissent leurs liens avec les puissances émergentes telles que la Chine, l’Inde et la Russie afin de sécuriser les marchés de l’énergie, d’attirer les investissements et de renforcer la coopération en matière de sécurité. Ils exploitent également le potentiel de la coopération bilatérale et multilatérale avec l’ASEAN, la Malaisie et Singapour.
La transition du Golfe s’inscrit en fait dans la tendance mondiale à la diversification des partenariats économique, militaire et stratégique, qui dépendaient traditionnellement des Etats-Unis. Par exemple, l’Inde et le Royaume-Uni sont sur le point de finaliser un accord de libre-échange et l’économie asiatique émergente cherche également à conclure des accords similaires avec l’UE, L’AELE, la Nouvelle-Zélande et le Chili. Bien que ces efforts se soient accélérés dans le contexte de la récente incertitude commerciale mondiale, ils constituent aussi une réponse aux réalités géopolitiques contemporaines antérieures aux droits de douane américains. Au fur et à mesure de l’évolution de la demande et de la production des consommateurs et de l’augmentation des menaces pesant sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, les marchés émergents et établis du monde entier continueront à remodeler leurs alliances pour atténuer les risques.
Les Etats du Golfe tirent de plus en plus parti de leurs relations diplomatiques et de défense pour préserver leurs liens commerciaux internationaux et leurs intérêts économiques. Il s’agit notamment de diversifier la coopération en matière de défense pour y inclure la Chine, la France, la Corée du Sud, la Turquie et même l’Inde, afin de réduire la dépendance traditionnelle à l’égard des Etats -Unis en tant que garant de la sécurité dans la région. L’élargissement des partenariats de sécurité est également devenu crucial à un moment où la région est confrontée à des menaces multiformes notamment en matière de sécurité maritime et de perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Au-delà de la coopération militaire, les EAU, l’Arabie Saoudite , le Qatar et Oman ont également intensifié leurs efforts diplomatiques et de médiation. Les Etats du Golfe sont notamment devenus des interlocuteurs essentiels entre Israël et le Hamas, les Etats-Unis et la Russie, et les Etats-Unis et l’Iran.
Cette diversification stratégique n’est ni une coïncidence ni un affront direct aux Etats-Unis. D’une part, il est essentiel pour la région du Golfe de forger des alliances nouvelles et indépendantes afin de s’émanciper des Etats-Unis. La région a besoin d’autres partenaires pour assurer sa diversification économique et sa transformation intérieure. D’autre part, les Etats de la région se rendent compte que l’influence américaine sur le commerce mondial, la politique et la sécurité n’est pas susceptible de diminuer à court ou moyen terme. C’est pourquoi ils tirent parti de leurs liens croissants avec la Chine, la Russie et l’Iran pour servir de pont diplomatique entre les Etats-Unis et leurs adversaires.
Bien que prometteuse, la réorientation stratégique du Golfe n’est cependant pas sans poser de problèmes. Si la recherche de nouveaux partenaires dans la région est riche en opportunités, elle est également marquée par le défi que représentent les rivaux du Golfe qui se disputent les mêmes grandes alliances à l’échelle mondiale. C’est notamment le cas de l’Arabie Saoudite et des EAU qui ont tous deux accès à des corridors commerciaux cruciaux tels que l’IMEC et la « route de la soie », ainsi qu’à des emplacements géostratégiques similaires. Tous deux investissent massivement dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, les minerais, la fintech, l’IA et la logistique, avec plus ou moins de succès. En outre, en tant qu’Etats dotés d’importants fonds souverains et d’une base de consommateurs croissante, ils sont tous deux des destinations de choix pour les investissements directs étrangers. À ce titre, les deux pays sont inévitablement en concurrence pour obtenir des accords commerciaux lucratifs, des accords de défense et des engagements diplomatiques. Cette situation peut affaiblir l’intégration économique régionale.
En outre, les États du Golfe devront également équilibrer leurs liens avec des partenaires internationaux tels que l’Inde et la Chine, qui entretiennent des relations difficiles entre eux mais des liens positifs avec la région. Outre les tensions bilatérales en matière de sécurité entre les deux géants asiatiques, l’Inde et la Chine rivalisent également en offrant d’énormes marchés de consommation pour les exportations du Golfe. Enfin, les États du Golfe continueront à faire face à des défis financiers dans un contexte de prix du pétrole durablement bas, ce qui limite considérablement la capacité de la région à investir dans de nouveaux partenariats.
En bref, dans le contexte actuel de fracturation de la mondialisation en blocs, de nouvelles alliances régionales et transnationales redéfinissent les relations commerciales ; et les États du Golfe comptent parmi les principaux acteurs de ce changement. Cette transformation n’en est qu’à ses débuts et, à mesure que la volatilité géopolitique se poursuit, cette diversification deviendra une nécessité plutôt qu’une option. En outre, la transformation interne des États du Golfe renforce la confiance internationale dans l’investissement et le partenariat avec ces pays. Pour la région, équilibrer ces nouvelles alliances avec celle des États -Unis restera donc une vraie priorité afin de tirer le meilleur parti des relations économiques d’un monde multipolaire.